[Lexique Canicule] Comprendre pour mieux s’adapter

Qu’est-ce qu’une canicule ? Une vague de chaleur ? Un dôme de chaleur ? Retrouver nos explications en image dans…
Télécharger (681ko)Du fait de sa très forte densité urbaine et de l’accélération des vagues de chaleur, la Ville de Paris fait partie des plus vulnérables face au réchauffement climatique. Si des aménagements urbains sont mis en place pour atténuer et adapter la ville à ces effets, des actions concrètes sont également à mettre en place par les Parisiennes et les Parisiens au sein de leur logement.
Améliorer le confort de mon logement en été passe par des usages individuels et, si possible, des actions collectives en copropriété. Tour d’horizon des solutions.
À Paris, l’intensité des vagues de chaleur est renforcée par le phénomène « d’îlot de chaleur urbain ». Ce phénomène climatique propre aux villes se manifeste par un réchauffement local de l’air par rapport à sa campagne environnante. En cause plusieurs facteurs :
La température moyenne à Paris avant l’ère industrielle (1885) était de 10,7°, celle de 2010 de 13°, celle de 2050 devrait atteindre 13,5° et cette augmentation va continuer de façon accélérée dans les décennies à venir.
35
Au moins 35 nuits tropicales par an sont à prévoir avant la fin du siècle (températures minimales ne descendant pas en dessous des 20°C).
La fréquence et l’intensité des épisodes caniculaires vont fortement augmenter (épisode de températures élevées, de jour comme de nuit, sur une période prolongée d’au moins 3 jours).

Qu’est-ce qu’une canicule ? Une vague de chaleur ? Un dôme de chaleur ? Retrouver nos explications en image dans…
Télécharger (681ko)Une surmortalité est constatée lors des vagues de chaleur, particulièrement chez les personnes vivant au dernier étage d’un logement non-isolé.
Mais des symptômes nous touchent tous : « coup de chaleur », déshydratation, manque d’énergie, manque de sommeil, etc.
Les logements ne sont pas toujours adaptés à ces fortes chaleurs, aussi nous vous proposons des solutions simples à mettre en œuvre chez vous pour éviter la surchauffe tout en ayant un impact limité sur l’environnement.
Le rayonnement solaire est la principale source de chaleur dans un logement : il représente environ 50 % de l’apport en chaleur, et l’équivalent d’un radiateur par fenêtre. Il est donc important de fermer vos fenêtres dès que la température extérieure est plus élevée que celle de l’intérieur, afin de ne pas réchauffer la pièce.
Si vous avez des volets, stores, rideaux vous devrez les fermer en même temps que les fenêtres. Sinon, pensez à en installer pour stopper le rayonnement du soleil chez vous.
Pour une meilleure protection, il faut privilégier si possible des occultations par l’extérieur, car elles évitent l’effet de serre derrière la vitre. Les stores ou volets à projection sont particulièrement adaptés car ils permettent de garder la lumière à l’intérieur tout en se protégeant des rayons du soleil.
Néanmoins, si ces équipements sont inexistants ou compliqués à installer, vous pouvez installer des occultations intérieures comme des rideaux isolants thermiques (à base de laine) ou des volets intérieurs ou stores vénitiens.
Les films de protection solaire pour vitre ont pour principale fonction de filtrer les rayons du soleil et d’empêcher une partie des infrarouges de traverser la fenêtre, réduisant par extension la température de la pièce et l’éblouissement. Ils n’altèrent pas la luminosité d’une pièce et se posent sur la face extérieure de la fenêtre.
Attention néanmoins, il s’agit d’une solution à moyen terme car ces films ne sont pas facilement repositionnables et il faut savoir qu’ils peuvent aussi limiter l’apport de chaleur en hiver.
Le chaud migre toujours vers le froid, aussi dès que la température extérieure est plus fraîche que la température intérieure ouvrez largement vos fenêtres. Aérer pendant les heures fraîches (tôt le matin, en soirée et la nuit) est une manière naturelle de rafraîchir l’espace de vie. Quand les ouvertures du logement le permettent, il est conseillé de créer un courant d’air en ouvrant des fenêtres sur différentes façades, si possible opposées.
On peut aussi en fin de journée laisser sa porte d’entrée ouverte sur le palier pour évacuer la chaleur du logement. Les parties communes (sans fenêtres) sont souvent beaucoup plus fraiches.
Le courant d’air brasse le logement et permet de décharger la chaleur accumulée dans les parois à forte inertie.
Le ventilateur est un bon moyen pour ressentir une sensation de fraîcheur grâce au brassage de l’air. Les ventilateurs portables ou plafonniers sont précieux pour créer de la fraîcheur spécifiquement au cours des heures les plus chaudes de la journée quand l’ouverture des fenêtres n’est pas recommandée.
A noter qu’il est inutile de laisser tourner un ventilateur quand une pièce est vide, car celui-ci ne fait que brasser l’air.
Dans les grands espaces il peut être envisagé de placer un brasseur d’air au plafond, plus puissant et avec une capacité de ventilation supérieure. Sa consommation d’énergie et le bruit qu’ils génèrent ne sont pas adaptés à toutes les situations.
Le climatiseur est non seulement très énergivore mais il réchauffe encore davantage l’air extérieur. Si elle peut satisfaire un besoin réel, la climatisation produit des effets sur l’environnement qui accentuent les problèmes mêmes auxquels elle est sensée répondre, puisqu’elle émet des gaz à effet de serre puissants et réchauffe la ville et le climat .
L’humidité couplée à un l’air diminue fortement la sensation de chaleur. Pour rafraîchir l’air, il est possible d’accrocher un drap ou une serviette humide à la fenêtre. Au contact de l’eau, la chaleur de l’air va s’évacuer, ce qui va contribuer à rafraîchir la pièce. Vous pouvez également mettre une serviette humide ou une bouteille d’eau congelée devant votre ventilateur ou tout simplement votre linge à sécher (et éviter ainsi l’usage d’un sèche-linge). C’est le principe de rafraîchissement ou refroidissement « adiabatique ».
Ce système peut être également proposé dans le commerce, à destination des logements. La puissance de ces rafraîchisseurs d’air permet de gagner 3 à 4 degrés dans une pièce de 15 m². Il est préférable de privilégier des appareils qui proposent une contenance d’eau minimale de 5 litres, et disposant d’au moins trois vitesses de ventilation.
Il est conseillé d’humidifier sa peau et de se baigner régulièrement pour faire baisser la température du corps. Particulièrement à l’intérieur des coudes et des genoux, les pieds (par exemple en mettant une bassine pour ses pieds) et la tête (en portant un couvre-chef mouillé). Vous pouvez aussi porter des vêtements amples.
La végétation est un moyen naturel de rafraîchir : sur le balcon, les rebords de fenêtres, dans la cour… Il est intéressant de se procurer des plantes à fort taux d’évapotranspiration et de les arroser le soir pour profiter de leur fraîcheur.
Il est également possible d’arroser le sol du balcon. Attention toutefois : il est préférable pour cela de réutiliser l’eau (du lavage des légumes par exemple) pour éviter la surconsommation de l’eau potable, surtout en période de sécheresse.
Il est conseillé de réduire au maximum tout apport de chaleur dans le logement : cuisine, eau chaude, appareils électriques et électroniques rejettent beaucoup de chaleur.
Cuisiner chaud va contribuer à réchauffer la pièce, notamment par l’utilisation des plaques de cuisson, fours, micro-ondes, etc… Il est donc conseillé de limiter l’utilisation de ces appareils et de consommer des plats qui nécessitent moins de cuisson ! Privilégiez les repas froids et programmez la cuisson aux heures les moins chaudes.
Quand ils sont allumés ou en mode veille, les appareils électroniques tels que les ordinateurs, téléviseurs, smartphones, boxs, etc. émettent de la chaleur. Eteignez-les dès que vous n’en n’avez pas l’usage.
Il peut être aussi judicieux de limiter l’utilisation d’eau chaude, pour la cuisine ou encore la douche. Un tuyau d’eau qui transporte l’eau chaude sanitaire entre la chaudière et les robinets peut faire office de petit radiateur à cause des déperditions de chaleur. Nous vous conseillons ainsi de calorifuger (isoler) les tuyaux qui acheminent l’eau chaude sanitaire dans votre logement grâce à des manchons de protection.
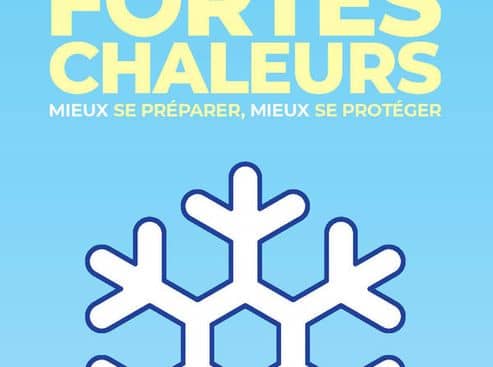
Pour découvrir les bons gestes à adopter pour vous protéger des fortes chaleurs à venir, consultez les conseils de la…
Télécharger (279ko)Si les solutions que nous avons énoncées permettent de contribuer à rafraîchir les logements sur le moment. Il est également important d’avoir une vision à long terme dans le cadre du changement climatique et de la multiplication des jours de canicules.
Plusieurs solutions peuvent être envisagées pour mieux résister à la chaleur :
Bien isoler les murs et les toits de son logement avec des matériaux à forte inertie pour ne pas laisser la chaleur s’introduire et en utilisant des matériaux biosourcés qui permettent de retarder les effets de la chaleur.
Installer une peinture réfléchissante en toiture, peut faire gagner quelques degrés aux logements des étages les plus hauts. Isoler c’est mieux, mais les deux peuvent se faire.

Qu’est-ce que l’îlot de chaleur urbain ? Quels sont ses enjeux dans le contexte parisien ? Comment adapter les territoires…
Télécharger (1929ko)La Ville de Paris a mis en place le dispositif Éco-Rénovons Paris+, qui propose aux copropriétés parisiennes un accompagnement gratuit et personnalisé ainsi que des aides financières pour la réalisation d’un projet de rénovation globale. Des primes pour intégrer des actions d’amélioration du confort des logements en période estivale sont également disponibles afin de contribuer à adapter la ville au changement climatique, et protéger les Parisiennes et Parisiens des fortes chaleurs.
Éco-Rénovons Paris+ : des aides pour adapter les logements aux fortes chaleurs